Au début de ma thèse, j’ai écrit plusieurs textes et présenté deux conférences sur le travail de l’artiste japonaise Atsuko Uda. Un de ces projet de recherche a été publié dans l’ouvrage Formes audiovisuelles connectées en 2018.
Je souhaite ici revenir sur le travail des Hands-on Movies que l’artiste a produit autour de 2000. Écrit comme de courts comics strips interactifs, ces poèmes vidéos cliquables interrogent l’idée d’une image qui serait lue et non plus regardée. Ces formats ont été produits pour le web et aujourd’hui obsolètes, sont travaillés comme des formats à dérouler avec les gestes du curseur. Interviewée par le chercheur Jean Louis Boissier, l’artiste relève que « Visionner ce travail revient à lire de petits comics strips comme quand on est tout seul. L’écran se partage en deux parties et vous regardez des histoires différentes en même temps. » L’interactivité spécifique au web permet ce déploiement qui, rétrospectivement, questionne de manière pertinente nos actions sur internet et notamment celle de perdre du temps en ligne, de ne rien y faire de particulier ou d’y partager un temps narratif.
Je souhaiterais donc m’arrêter de nouveau sur A Couple. An Autumn Day d’Atsuko Uda.
Winter. Sunday afternoon.
Echo of the sound of boiling kettle.
Drinking hot tea.
Atsuko Uda plante le décor, un seul lieu, une seule unité de temps et une seule action : une pause thé d’un couple japonais un dimanche après-midi. Lorsqu’on laisse la souris dans le blanc de la page web, on se trouve face à un plan de profil où le couple se fait face. Derrière chaque personnage un élément de nature, on suppose le jardin de la maison et ses fleurs derrière le personnage féminin à droite et un vieil arbre sans feuille, lui aussi qui sommeille probablement dans le jardin, à gauche. Si on place la souris sur l’image, elle se dédouble et les personnages sont cette fois-ci face caméra, prenant le point de vue de l’un et de l’autre. Si notre souris est à gauche de l’image, l’homme regarde l’objectif, si c’est à droite que traîne notre curseur c’est l’autre personnage qui lève les yeux. Celui que l’on pointe avec la souris nous regarde, ou plutôt regarde vers l’autre : à la fois le spectateur et le personnage qui lui fait face. En pointant, nous montrons un personnage, celui-ci nous regarde, nous marquons une pause, un arrêt de l’action en cours. Ces personnages cherchent le dialogue par le regard mais sont aussi dérangés par ce geste, ils sont extirpés de leur pause thé. Ils sont à la fois dans l’attente d’une discussion que le spectateur semble amorcer, à la fois dérangé par la rupture de ce doux silence.
Et pour l’interaction avec l’image, ça s’arrête là. Pas d’autre action possible, pas d’autre image à découvrir, juste ce couple qui lève les yeux et boit son thé automnal.
L’ensemble est composé de trois boucles vidéo : la première quand la souris n’est pas sur l’image, la deuxième quand le curseur est sur le personnage de gauche et la troisième quand il est sur celui de droite. Et ce sera forcément le cas, peu importe l’ordre dans lequel on voit ces trois boucles. Cet enchaînement amène une forme de latence de l’œuvre, si vous n’êtes pas là, ils vont quand même boire leur thé. Contrairement aux spectateurs, ces deux personnages ne quitteront jamais leur pause, ils sont enfermés dans ce petit geste du quotidien, dans une durée qui semble infinie et non quantifiable par son aspect figé. L’écriture de cette attente est un point central pour démarrer une interaction. Jean-Louis Boissier ajoute «Le problème concret dans un récit interactif, où la suite dépend du geste du lecteur, qui reste en suspens si le lecteur ne fait rien, c’est précisément de fabriquer cette suspension qui permet au lecteur de ne rien faire. Le déclenchement, la sortie de la boucle, apparaissent alors comme le degré zéro de la bifurcation.» La composition est donc rudimentaire, une boucle qui en amène deux autres, on passe de l’une à l’autre sans cesse, on fait varier l’axe de vue sur cette pause thé infinie. La transformation notable réside dans le regard caméra des deux personnages. La scène se met en pause et ne quitte cet état figé que lorsque le spectateur enlève le curseur de l’image. En obtenant ce regard du personnage, on entre en contact avec lui, on le libère de la boucle dans laquelle il est enfermé. C’est un peu comme libérer le personnage de son statut pour lui redonner celui d’être humain, son regard quitte un instant la planéité de l’image pour se projeter dans l’espace du spectateur. C’est récupérer une intimité avec quelqu’un, intimité que la vidéo empêche totalement. C’est instant de pause c’est comme figé le temps pour pouvoir, l’espace d’un instant, rentrer en contact avec les deux personnes présentes. Cette relation à l’image filmée actualisée ne peut se faire que dans une durée qui devient celle du spectateur, celle du mouvement du curseur. Elle va varier si le spectateur est interloqué, gêné, amusé ou nullement réceptif à ce projet.
On est bien ici face à un phénomène complexe. Il s’agit d’une image tournée en amont, et donc irrémédiablement passée. Mais son actualisation, sa mise en boucle finit par faire ce que cherchait Louis Buñuel, la libérer du temps, où plutôt l’encrer indéfiniment dans le présent. L’actualisation et le jeu du regard apporte une présence, une interaction directe avec le regardeur qui entre dans la scène sans y être invité. Le regard caméra n’est pas un effet cinématographique nouveau, il a permis à de nombreuses reprises de créer un contact avec le spectateur. Mais ici, c’est ce dernier qui active le regard caméra, qui interpelle le personnage. Ce n’est pas l’auteur qui a décidé qu’à ce moment précis le personnage devait regarder vers l’objectif mais celui qui regarde qui décide de marquer sa présence. Une image filmée ne peut pas être, par nature, au présent, et pourtant son actualisation l’y ramène indéfiniment. La vraie difficulté phénoménologique ici, c’est que la narration intègre celui qui regarde et sa temporalité avec. Le passé intègre le présent et les personnages semblent indéfiniment vivants. Je navigue dans une base de données qui est bien là, qui est bien présente et qui s’actualise devant moi. On est au milieu de cette difficulté perceptive que met en avant Henri Bergson entre le temps-quantité et le temps-qualité. Le premier peut m’indiquer le nombre de boucle que j’ai vu, le temps passé devant l’écran mais ne peut en aucun cas me donner le ressenti temporel que j’ai eu devant ces vidéos, devant ces regards qui me scrutent. C’est un temps perçu différent qui est celui de la brève relation que j’ai avec ces deux personnages.
*
Mais aujourd’hui, en 2025, c’est en lecteur fatigué de la vitesse du web que je regarde de nouveau ce travail. Perdu dans les limbes des archives d’internet, je retrouve ce couple, continuant de boire un thé, coincé dans la boucle d’un langage obsolète. Toujours là, calmes, pensifs, ils proposent une rupture à la vitesse contemporaine, redonne à l’automne son charme, nous arrête juste une seconde pour réfléchir au sens de cette vitesse, de ces milliers d’images digérées chaque jour, de ces kilomètres de publicité parcourus. La durée bergsonienne n’a jamais résonné aussi fort en moi car c’est à mon temps-quantité que l’économie de l’attention s’attaque, je peux donc résister en temps-qualité, à condition de prendre le temps de regarder, de lire, d’interagir avec les formes qui le permettent.
C’est en participant à une pause thé numérique que je reprends le contrôle sur mes espaces virtuels, que je réfléchis à ma condition d’être humain numérisé, que je retrouve du sens à cette forme narrative interactive minimale. Bien plus encore que la première fois.
Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris : Presses Universitaires de France, 1970.
Atsuko Uda, A Couple, Hands-On Movie, 1999-2001
Pierre Barboza, Jean-Louis Weissberg, L’image actée : scénarisations numériques, parcours du séminaire « L’action sur l’image », Paris : L'Harmattan, 2006.
Jean-Louis Boissier, « L’image-relation », dans La relation comme forme : l’interactivité en art, nouvelle version augmentée, Dijon : Les presses du réel, 2008
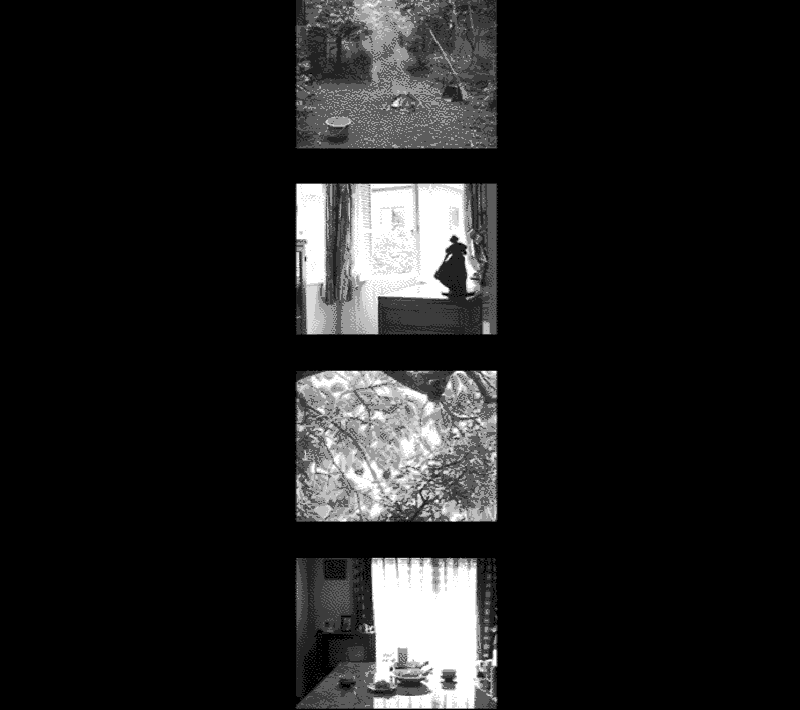
FIG 01. Atsuko Uda, A Couple. An Autumn Day, 2000